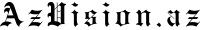Mis en service en 1983, le réacteur accidenté est de type RBMK, une conception soviétique des années 1960, dont l'évaluation du niveau de sûreté réalisée après la catastrophe montrera de nombreux défauts dans la conception initiale. De plus, avant l’accident les opérateurs n’ont pas respecté toutes les règles de conduite et ont inhibé de très importants systèmes de sûreté.
Depuis quelques années, une arche recouvre le réacteur détruit et le sarcophage construit dans l’urgence après la catastrophe et qui s’est dégradé au fil du temps. Son étanchéité et des équipements spécifiques permettront d’entamer les opérations de démantèlement.
Depuis l’achèvement d’un nouveau sarcophage, les travaux préparatoires au démantèlement de la centrale nucléaire se poursuivent. Désormais évoquée, la reconquête de la « zone d’exclusion » autour du site apparaît toutefois difficile à réaliser. Enfin, dans les territoires contaminés d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie, les impacts sur l’environnement et la santé restent visibles.
L’accident a également fait surgir des questions inattendues sur les effets des faibles doses et montré des lacunes de la connaissance dans ce domaine. L’IRSN a engagé des programmes de recherche pour améliorer ces connaissances. Envirhom étudie l’effet des faibles doses sur l’animal. Le projet EPICE conduit une étude pilote sur les enfants des territoires contaminés (en Russie). L’Initiative Franco-Allemande pour Tchernobyl (IFA), dans son volet Santé, a établi une base d’information sûre et objective sur les effets sanitaires en Ukraine, Biélorussie et Russie.
Enfin, le 4 avril 2020, un incendie s’est déclaré en Ukraine dans la zone d’exclusion autour de la centrale de Tchernobyl. Un tel évènement, qui s’est déjà produit par le passé, peut conduire à la remise en suspension de césium 137 dans l’air.
Source: irsn.fr
Tags: Tchernobyl accident Ukraine